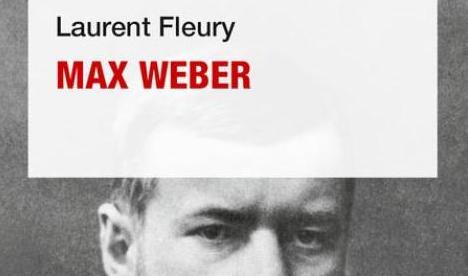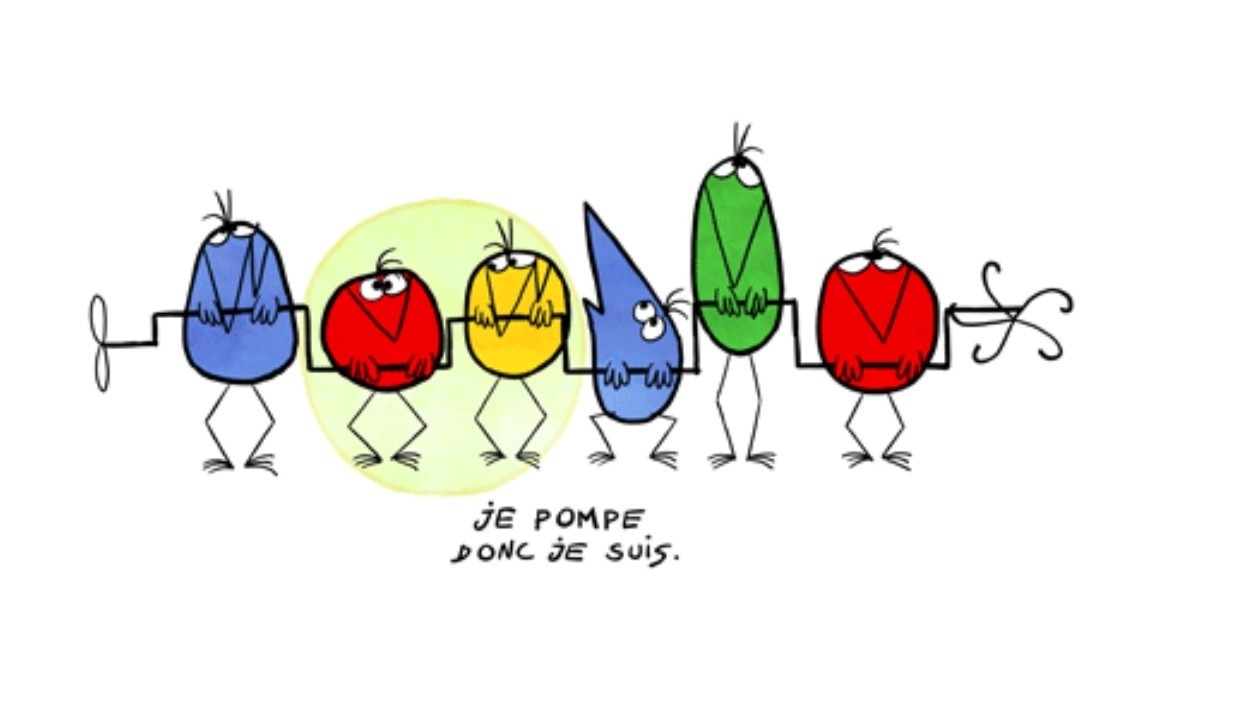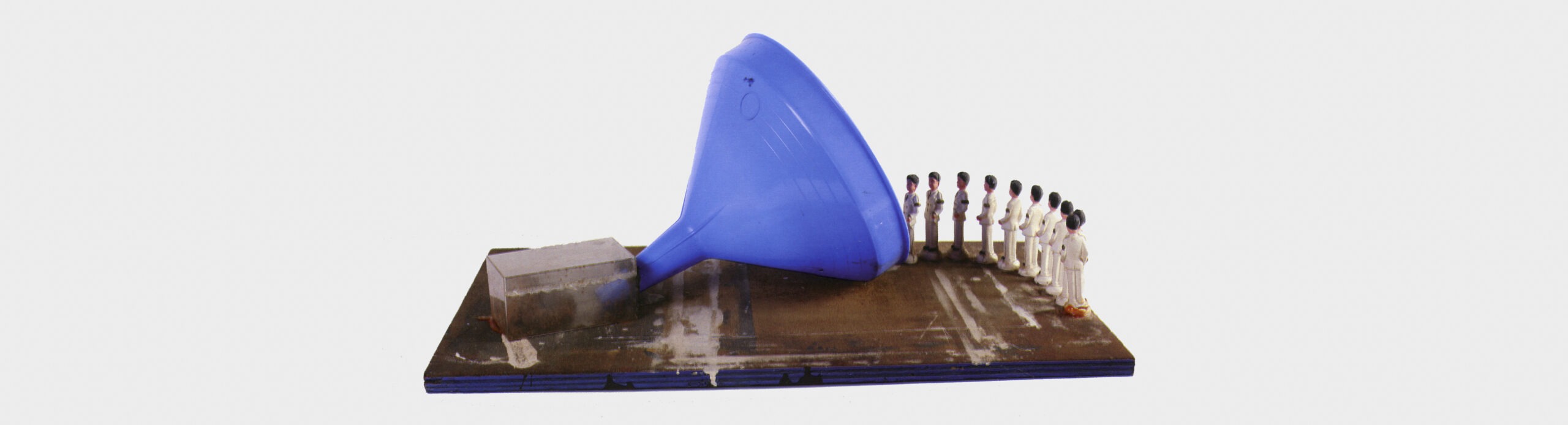
LCSP - Laboratoire de Changement Social et Politique
Le LCSP (Laboratoire de Changement Social et Politique) regroupe sociologues, anthropologues et philosophes, menant leurs recherches sur le changement social, dans une perspective inter et pluridisciplinaire. Critiques des formes d’assujettissements contemporains, elles et ils explorent les conditions et processus de subjectivation, luttes, émancipation et dégagement, etc.
Axes de recherche
Sociologie clinique et psychosociologie
Art, culture et politique
Théorie sociale et pensée politique
Genre et intersectionnalité